En règle générale, les
projecteurs professionnels ne sont
pas munis d'un dispositif de mise au point automatique (auto-focus).
La précision de la mécanique fait que toutes les
dias tombent
toujours de la même manière et exactement au
même endroit dans
le couloir de projection.
Pour n'être pas obligé de retoucher à la mise au point pendant une projection, il faut:
Les caches verre sont des montures constituées de
deux
parties qui se referment par clipsage, enfermant le film entre
elles, en sandwich. Chaque partie est équipée
d'une plaque de
verre qui fait que le film est solidement maintenu à plat et
ne
peut donc pas se gondoler sous l'effet de la chaleur de la lampe
de projection.
Le film étant toujours positionné au
même endroit par rapport
au dispositif optique, le réglage de netteté ne
varie pas en
cours de séance.
Il esiste plusieurs fabricants de caches verre, et plusieurs
modèles chez chacun d'eux.
Les marques les plus répandues sont Gepe
et Wess.
Les caches et accessoires de la marque Wess peuvent être
approvisionnés auprès de la
société Electrosonic.
Pour ma part, j'utilise des caches 5x5cm pour film 24x36 de
marque Gepe
type 6050 (ou 6150 si on les achète par 1000),
d'épaisseur 2,5mm,
avec fenêtre aluminium, verres traités
anti-Newton, et registrés.
Ces caches font partie de la gamme professionnelle du fabricant
mais restent d'un prix raisonnable.
"Registré" signifie que le film
n'est
pas simplement maintenu par pression entre les deux plaques de
verre, mais que ses perforations s'ajustent à des ergots
judicieusement placés dans la monture. Ainsi, le film ne
peut
pas se déplacer en glissant dans le cache.
Corollaire: toutes les diapositives doivent être
exposées dans
un appareil photo "registré" garantissant une
reproductibilité du positionnement de l'image par rapport
aux
perforations.
Cette caractéristique est surtout incontournable pour les
images
panoramiques recomposées, appelées "softs"
(Soft Edge slides, c'est à dire diapositives à
bords "adoucis"),
utilisant plusieurs projecteurs simultanément pour
reconstituer
sur l'écran une image scindée en plusieurs
diapositives. Les
duplicatas doivent être réalisés sur un
banc diviseur muni
d'ergots de positionnement (Voir le splitter Wess en bas
de page).
Le format d'écran 3x1 que j'utilise permet basiquement de projeter trois types d'images:
Il va sans dire que l'utilisation de 6 projecteurs permet de
basculer sans trou en fondu-enchaîné d'un
écran complet au
suivant, quelque soit le type d'image projeté.
L'utilisation de 9 projecteurs m'autorise un rythme de passage de
diapos plus soutenu, si nécessaire, ainsi que certains
effets
comme la projection de titres
ou
d'incrustations de formes spéciales par dessus des images
triples qui se succèdent en
fondu-enchaîné.
Le "soft" (Soft Edge) est une image unique (au
format 3 x 1 dans mon cas), qui couvre la totalité de mon
écran
de 4,20m x 1,40m.
Les appareils photo classiques ne sont pas prévus pour des
prises de vue à ce format.
On peut tenter de prendre trois photos successives en
décalant
à chaque fois horizontalement l'appareil d'une valeur
constante.
C'est la méthode qui donnera la meilleure qualité
de
projection, mais quelle épreuve que cette prise de vue!
Aucun décalage
vertical n'est toléré, et il vaut mieux que le
sujet soit
immobile! Ce système est exclu pour la photo rapide.
En règle générale, j'utilise une autre
méthode. L'astuce
consiste à sélectionner sur la diapo 24 x 36
d'origine une zône
couvrant toute la largeur de l'image, mais seulement la
moitié
de sa hauteur et de dupliquer cette zône en 3 diapos
décalées
distinctes qui seront projetées simultanément
pour recréer sur
l'écran une seule image panoramique.
Inconvénient: l'image obtenue correspond à un
agrandissement de
facteur 2 de l'image d'origine, et donc de ses défauts de
netteté
et de grain.
Il faut bien entendu que le sujet de la diapo se
prête au
panoramique et que la zône intéressante de l'image
soit plutôt
axée horizontalement que verticalement.
Exemple: une photo de la tour Eiffel serait très difficile
à
traiter en soft panoramique, en revanche, un bateau-mouche sur la
Seine serait un bon sujet.
Voici un exemple de diapositive traitée en "Soft Edge". Il s'agit d'une photographie du Conseil de l'Europe, à Strasbourg.
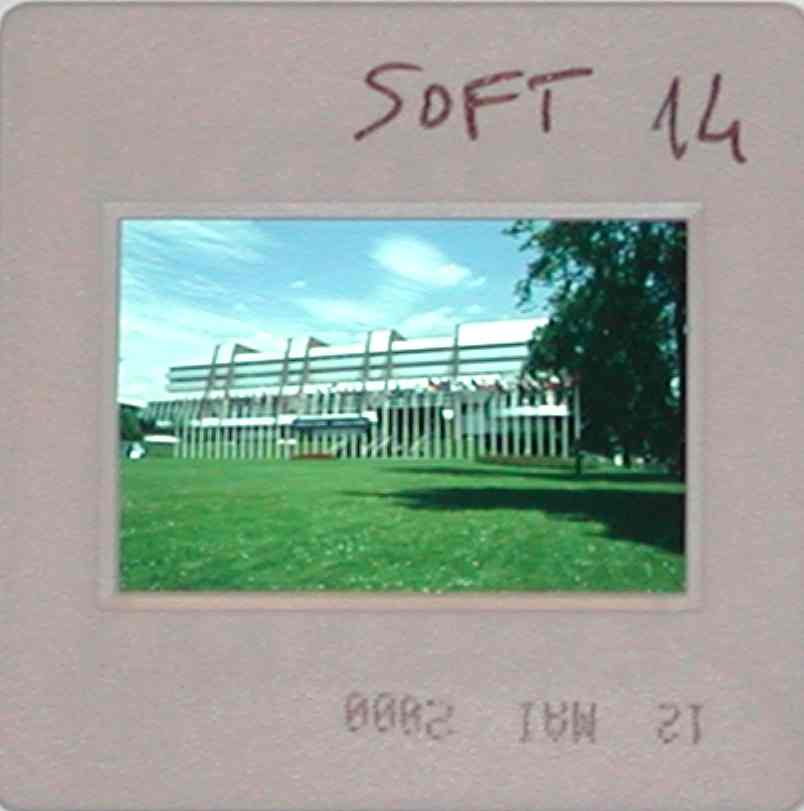 |
 |
 |
|||
|
La diapo d'origine |
Sélection de la zône utile |
Duplication en 3 images décalées dans le splitter Wess, et masquage |
 |
|
| L'image finale projetée |
Cette image est une photo (non retouchée) de l'écran sur lequel sont projetées, via 3 projecteurs Simda 2200, les 3 diapositives masquées ci-dessus. Les zônes de recouvrement sont imperceptibles.
Un second exemple (nostalgie...):
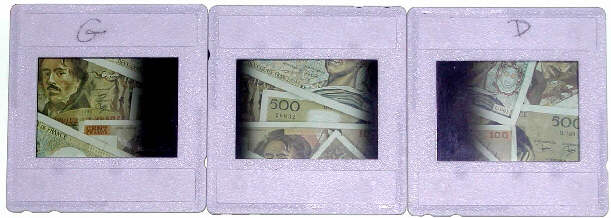 |
|
| Les trois diapositives décalées et "masquées" qui constituent le SOFT |
 |
|
|
Photo de l'écran de projection |
Dans la mesure où chaque projecteur ne couvre
horizontalement
qu'une portion de l'écran, un soft doit être
projeté par trois
projecteurs, chacun d'eux prenant en charge un tiers d'image (gauche,
milieu et droite), avec un fort taux de recouvrement.
En pratique, les deux projecteurs latéraux couvrent chacun
la
moitié de l'écran en largeur. L'image du
projecteur central est
superposée aux deux images latérales, qu'elle
recouvre pour
chacune à moitié.
Si les images étaient projetées "bord à bord" sur l'écran, la limite entre deux images contigües serait impossible à cacher: le positionnement des projecteurs ne pouvant être parfait, il y aurait toujours - ou recouvrement, - ou une bande noire entre deux images contigües.
Les trois tiers d'images sont donc "maquillés" pour
que le recouvrement existe, mais soit masqué aux yeux du
spectateur.
On applique à l'image de gauche un masquage progressif
grisé
qui commence un peu au-delà du milieu de l'image et qui est
de
plus en plus noir et opaque à mesure que l'on approche de la
droite.
L'image de droite subit le même masquage progressif du milieu
vers son bord gauche.
Quant au tiers d'image du milieu, il se voit appliquer un double
masquage grisé progressif. Seul le centre de la diapo est
clair.
L'image s'assombrit à mesure que l'on se rapproche des bords
gauche et droit.
La densité du masquage est
étudiée pour qu'à tout endroit
de l'écran, la luminosité soit la même.
Sinon, dans les
recouvrements, l'image serait deux fois plus lumineuse,
étant
issue de l'addition du rayonnement de deux projecteurs.
Cependant, les inévitables disparités entre
projecteurs font
que les zônes de recouvrement deviennent perceptibles quand
l'image projetée comporte de grandes parties claires: c'est
le
cas, par exemple, de la photo de flamant rose qui illustre la
page d'accueil de ce site.
NB: toutes les photos panoramiques présentées ici ont été prises dans des conditions réelles de projection. L'écran a été photographié avec un petit appareil numérique, et la seule retouche effectuée a été le recadrage pour ne conserver que la surface utile de projection. Ces photos n'ont aucune prétention artistique: elles ne sont là que pour illustrer les techniques que j'utilise en diaporama.
Les diapos constituant un soft ne sont pas
maquillées à la
main!
Pour réaliser cette opération, on utilise des
films noir et
blanc à fort contraste (les transparents le sont vraiment,
et
les noirs ne laissent pas passer la moindre lumière),
déjà
exposés avec le dégradé voulu.
Ce film gris dégradé, appelé "masque",
est appliqué
contre la diapositive. Il est lui aussi pris en sandwich entre
les deux plaques de verre dans la monture du cache.
Si, dans un diaporama, coexistent des diapositives masquées
et
d'autres non masquées, il faut monter le masque du
coté de l'émulsion
qui sera orienté vers l'objectif de projection, et non vers
la
boite à lumière du projecteur: ainsi,
l'épaisseur du masque ne
viendra pas modifier le réglage de netteté par
rapport à une
diapositive sans masque. J'en profite pour rappeler que le
côté
le plus clair des caches bicolores doit se trouver vers
l'arrière,
c'est à dire vers la boite à lumière,
pour réfléchir un
maximum de rayonnement et s'échauffer le moins possible.
On trouve, par exemple chez Bargy
Images
75 rue d'Alleray 75015 Paris, ou chez Electrosonic
118 rue de Crimée 75019 Paris, des masques
dégradés dont la zône
grisée est plus ou moins importante. Sur un "soft",
une grande zône masquée pardonne davantage les
petits défauts
d'alignement qu'une petite. Les grandes parties claires y sont
aussi moins "maltraitées".
Personnellement, j'utilise des masques centraux MSA 025 ou MSA054,
et des masques latéraux MSA 024 ou MSA 063 ou encore MSA053.
Il
existe aussi d'autres masques de formes variées qui
permettent
des effets spéciaux intéressants. Les masques
à zône ronde ou
ovale "mâle" et "femelle" autorisent des
effets d'inscrustations d'images que je mets souvent en oeuvre.
Pour limiter l'investissement (les masques coûtent
entre 1 et
2 euros HT pièce, selon la quantité, et il en
faut 3 par image
soft), on peut aussi réaliser la reproduction de la
diapositive
en intercalant contre le film duplicating au moment de
l'exposition un film dégradé spécial,
appelé master-soft.
L'image originale est ainsi "masquée" avant
d'impressionner le film vierge. Wess
fournit ce
film master sous la référence SE6182.
Le résultat obtenu est moins bon, car le masque doit pouvoir
passer progressivement du transparent parfait au noir complet.
Or, sur le film diapo, le noir n'est jamais assez dense, et
laisse toujours passer légèrement la
lumière. L'avantage (financier)
réside dans le fait qu'un seul triple
masque-étalon est
suffisant pour réaliser par contact tous les softs que l'on
désire.
La diapositive d'origine doit être
dupliquée en trois
exemplaires décalés: partie gauche de l'image,
milieu et partie
droite. Pour cette opération, on peut difficilement utiliser
un
souffet ou un tube classique de duplication monté sur un
boitier
24x36.
Il faut en effet agrandir l'image d'origine d'un facteur 2 au
minimum en la recadrant (ne pas oublier qu'on va en sacrifier la
moitié de la surface en hauteur) et le décalage
latéral entre
les trois duplis doit être extrêmement
précis pour que le
recouvrement à masque progressif soit invisible lors de la
projection.
J'utilise donc, en chambre noire, un "splitter"
de marque Wess, référence SE6000 (voir la
société Electrosonic)
et un agrandisseur à tête couleur.
La diapositive d'origine est introduite dans l'agrandisseur et
son image est projetée vers le splitter qui est
posé sur la
table. Le splitter est une platine métallique s'ouvrant
comme un
livre pour mettre le film vierge en place et munie de petites
fenêtres
d'occultation. Une fois faite la sélection de la portion
d'image
voulue et la mise au point, on éteint l'agrandisseur et,
dans
l'obscurité, on positionne dans le splitter une longueur de
film
duplicating en le clipsant sur des ergots au pas des perforations
de la pellicule. On exposera le film à trois reprises en
ouvrant
à chaque fois une des petites fenêtres et en
décalant d'un
cran la partie mobile du splitter.
On obtient de la sorte trois diapositives 24 x 36 reprenant
chacune une partie de l'image d'origine, avec exactement le
décalage
et le taux de recouvrement voulu.
Les ergots et les fenêtres du splitter sont placés
par
construction avec une précision qui assure le positionnement
parfait du film lors de son exposition. L'utilisation de caches
verre registrés garantit ensuite un taux de recouvrement
idéal
sur l'écran.
Il faut manier le film "à la main", en le sortant
progressivement de sa bobine et en le bobinant dans un autre
boitier démontable au fur et à mesure que l'on a
exposé une
portion de trois images. On peut ainsi allumer la lumière
(atténuée
quand même!) entre chaque soft pour faciliter la mise en
place
de la diapositive suivante dans l'agrandisseur.
Le film de reproduction que j'utilise est un grand classique du genre. Il s'agit du film Kodak Duplicating 5071 livrable en bobines de 36 poses ou en boite de 30 mètres. Il est spécialement équilibré pour la lumière artificielle halogène d'un agrandisseur, et sa très faible montée du contraste permet, après étalonnage de la tête couleur de l'agrandisseur, des duplicatas presques parfaits.
NB: Kodak a récemment remplacé le film 5071 par une nouvelle émulsion baptisée "EDUPE" qui bénéficie d'une plus grande latitude du temps d'exposition (0,01 à 10 secondes, contre 1 seconde pour obtenir de bons résultats avec le 5071) et qui convient apparemment aussi bien à l'éclairage tungstène qu'à la lumière du jour. Comme il me reste une bonne longueur de 5071 au congélateur, je n'ai pas encore pu tester ce nouveau film de duplication. Je n'ai pas essayé non plus le film duplicating de Fuji, le CDU.
Je déconseille les rouleaux de 36 poses, sauf s'ils
font
vraiment partie de la même série de fabrication,
car le film
repro devant être étalonné avant
utilisation, il faut réaliser
un bout d'essai avec différents dosages de jaune, magenta et
cyan, soit en ajoutant les filtres gélatine
adéquats, soit en
utilisant les réglages de l'agrandisseur si celui-ci est
équipé
d'une tête couleur.
Une fois le bon réglage trouvé, il reste valable
pour toute la
boite de 30 mètres, que l'on pourra utiliser au fur et
à mesure
des besoins en la conservant au frais et en remplissant juste le
nombre de bobineaux démontables nécessaires
à chaque
utilisation.
Au changement de rouleau, il suffit de soustraire la correction
de couleur notée sur l'ancien emballage de celle
réellement
utilisée sur l'agrandisseur et d'ajouter au
résultat la
correction indiquée sur le nouveau film: si les autres
conditions d'exposition n'ont pas changé (vieillissement de
la
lampe, objectif différent...), il ne sera pas
nécessaire de
gaspiller une nouvelle longueur de film en essais chromatiques.
Le développement (bains E6) est le même que pour la plupart des films pour diapositives. Il faut préciser au laboratoire de développement (professionnel, de préférence) de ne pas couper le film, car, comme celui-ci est déroulé à la main, l'espacement entre les groupes de 3 images n'est pas constant: il est donc obligatoire de faire soi-même la coupe et la mise sous cache (GePe 6050 ou Wess AAA002).

L'agrandisseur couleur Kaiser VCP7002 |

Le splitter Wess SE6000. Au premier plan, le logement où l'on place les deux bobines du film, débitrice et réceptrice pendant la mise au point. La plaque en relief au second plan est mobile horizontalement: elle se déplace latéralement pour présenter successivement trois portions du film à l'exposition. La plaque se soulève pour recevoir une longueur de film. Elle est munie de fenêtres d'occultation que l'on ouvre l'une après l'autre pour exposer trois fois le film avec le décalage nécessaire. |

Le splitter est prévu pour différents formats d'écran. Pour ma part, je n'utilise que les 3 volets d'occultation supérieurs. L'image de l'agrandisseur est projetée sur les deux cellules en haut et à gauche de la zône blanche. Avec le matériel dont je dispose, le temps d'exposition de chaque image est de 1 seconde à f/8 à 11 selon la luminosité de l'image d'origine. (Film 5071, lampe d'agrandisseur halogène 12V 100W et objectif 80mm). |
En utilisant le même procédé
de masquage grisé progressif
que pour les softs, il est possible de projeter côte
à côte
sur l'écran trois images différentes dont les
zônes de
recouvrement ne seront pas franches, mais progressives. De la
gauche vers la droite, on passe "en douceur" d'une
image à sa voisine sans pouvoir déterminer
exactement où finit
l'une et où commence l'autre.
Bien sûr, chacune des diapositives projetées sera
tronquée
d'environ un tiers de sa surface. Il s'agit de bien choisir en
fonction de l'emplacement du sujet principal si telle ou telle
diapo doit être placée à gauche, au
milieu, ou à droite.
En choisissant bien les diapos qui seront présentes
simultanément
à l'écran, l'effet obtenu peut être
très harmonieux, sachant
que les trois parties de l'écran sont
indépendantes, et peuvent
donc faire séparément l'objet de transitions en
fondu-enchaîné.
La créativité de l'auteur trouve là un
vaste champ à
exploiter.
On peut aussi bien séparer volontairement à l'écran les trois images carrées en les montant sans masques dans des caches qui occultent une partie du grand côté de l'image. Dans ce cas, il existe une bande noire entre chacune des trois images projetées. L'effet peut aussi être intéressant.
Le format de l'écran (3 x 1) se
prête à la
projection de deux images au format normal (3 x 2) côte
à côte.
Ici, pas de recouvrement. Les deux images sont juxtaposées
bord
à bord et projetées par les deux projecteurs
latéraux. Celui
du centre reste disponible pour, par exemple, superposer un titre
au milieu de l'écran, à cheval sur les deux
diapositives latérales.
Les diapositives sont montées simplement sous caches verre, sans masque.
La division de l'écran en deux
parties
distinctes peut aussi avoir un autre intérêt:
Le scénario du diaporama peut prévoir deux
"histoires"
différentes (mais liées), qui se
déroulent simultanément,
chacune en fondu-enchaîné sur une
moitié d'écran.
Les titres peuvent être réalisés au moins de deux manières différentes:
 |
Pour
photographier les titres, je me sers du chassis de mon agrandisseur
comme statif de reproduction. Je fixe sur la colonne mon appareil photo
Canon Eos 5, muni d'un objectif 50mm f/1,4 à la place de la
tête couleur de l'agrandisseur et je place sur la table la
feuille de papier portant le titre imprimé. Une exposition
de l'ordre d'une seconde à f/5,6 à 8 avec du film
noir et blanc arts graphiques à fort contraste (Kodalith ou
équivalent), et le tour est joué.
L'éclairage est optimum car constitué de deux sources "lumière du jour" (5000K) placées à 45°. |